Voilà à quelle machine à tuer, nous sommes exposés et confrontés dans le monde grâce aux psychopathes qui siègent au Pentagone, dont le fameux sioniste, Paul Wolfowitz, Théoricien de la violence, qui nous fabrique des ennemis imaginaires dans le monde et qui doivent participer activement avec la CIA/Mossad à former des groupes de mercenaires pour procéder aux changements de régimes dans les pays qu'ils convoitent et pour s'accaparer leurs richesses en provoquant de toutes pièces les révolutions dites colorées, pour placer leurs pions/caniches des USA et des Banksters Illuminati de la Mafia Khazare de Rothschild, dans l'objectif d'instaurer leur Nouvel Ordre Mondial.
C'est aussi contre cette mafia criminelle internationale que doivent lutter la Russie et la Chine !
Théoricien de la violence
Paul Wolfowitz, l’âme du Pentagone
par Paul Labarique
Depuis trente ans, Paul Wolfowitz participe à presque tous les cabinets civils du Pentagone. Intellectuel brillant, disciple de Léo Strauss, il justifie de la guerre par l’extension de la démocratie de marché. Il s’est fait une spécialité d’inventer des menaces imaginaires pour justifier de nouveaux crédits et de nouvelles aventures. Il a théorisé les interventions préventives et l’intimidation des « compétiteurs émergeants ». N’hésitant pas à s’ingérer dans la tactique militaire, il a imposé ses conceptions aux officiers de terrain.
Réseau Voltaire | Paris (France) | 4 octobre 2004

La position particulière de Paul Wolfowitz dans l’espace public états-unien, entre le champ politique et le champ universitaire, lui permet d’être à la fois proche des théoriciens du régime Bush, tout en y occupant des fonctions exécutives, au sein du département de la Défense.
Le fils de son père
Paul Wolfowitz est le fils de Jacob Wolfowitz, un juif polonais né à Varsovie, dont les parents ont émigré à New York lorsqu’il avait dix ans. Diplômé du City College de New York, Wolfowitz père obtient un doctorat en mathématiques à l’université de New York et devient dans la foulée l’un des meilleurs experts états-uniens en théorie de la statistique. Il est alors très proche du mathématicien hongrois Abraham Wald. Politiquement, Jacob Wolfowitz est un sioniste convaincu, engagé par ailleurs dans des organisations opposées à la répression soviétique des minorités et des dissidents.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacob Wolfowitz effectue des études pour l’armée états-unienne, au sein du département de statistique de l’université de Columbia. C’est à cette époque que naît Paul, en 1943. En 1957, la famille déménage en Israël, après que Jacob Wolfowitz eut accepté un poste à l’Université Technion. Paul réussit lui aussi des études brillantes : étudiant en mathématiques à l’Université de Cornell, il s’intéresse rapidement à l’Histoire et à la science politique. Il devient alors membre de l’Association Telluride, créée en 1910 par L.L. Nunn pour sélectionner l’élite universitaire de Cornell, comme cela se pratique sur la plupart des campus états-uniens [1]. C’est au sein de ce groupe qu’il est amené à rencontrer le philosophe Allan Bloom, qui multiplie les contacts avec les étudiants de Telluride, dont entre autres l’économiste Francis Fukuyama, le candidat à la présidence Alan Keyes, le spécialiste du renseignement Abram Shulsky, l’expert en soviétologie Stephan Sestanovich, et Charles Fairbanks, le spécialiste de l’Asie centrale.
Une éducation « straussienne »
Sous l’influence d’Allan Bloom, Paul Wolfowitz développe ses connaissances en sciences politiques, et son intérêt pour la philosophie de Leo Strauss [2], le mentor de Bloom. S’il choisit l’Université de Chicago pour effectuer son doctorat, c’est d’ailleurs parce que le philosophe allemand y enseigne encore.

Léo Strauss
Même si le maître quitte Chicago avant que Wolfowitz ne soit diplômé, et bien que le jeune homme ne se considère pas véritablement à l’époque comme un conservateur, il est aujourd’hui perçu comme un héritier intellectuel de Leo Strauss. En 2002, Jeane Kirkpatrick déclare ainsi dans une interview que, selon elle, « Wolfowitz reste une des grandes figures straussiennes » [3]. Il est vrai que le responsable états-unien axe son discours sur la fin de la tyrannie et la condamnation du Mal, sur la dichotomie dictature-démocratie, et sur les pouvoirs quasi-surnaturels qu’il accorde aux dictateurs, qui seraient capables, par malice, de tromper les démocraties libérales. Une argumentation élaborée pendant les dernières années de la Guerre Froide, qu’il reprendra ensuite à propos de l’Irak de Saddam Hussein.
Wolfowitz réfute aujourd’hui en partie le qualificatif de straussien. À Chicago, il s’est en effet trouvé un nouveau mentor, en la personne d’Albert Wohlstetter. Ce dernier, qui a étudié les mathématiques avec Jacob Wolfowtiz à Columbia, est alors le premier stratège nucléaire états-unien, membre de la Rand Corporation et théoricien de la vulnérabilité des États-Unis. Sous sa direction, Paul Wolfowitz rédige un mémoire sur les usines de désalinisation installées par Washington aux frontières d’Israël, de l’Égypte et de la Jordanie, officiellement pour impulser une collaboration entre Tel-Aviv et le monde arabe. Officieusement, l’un des produits dérivés du processus de désalinisation devait être du plutonium. Wolfowitz s’oppose, dans ce mémoire, à la nucléarisation du Proche-Orient, aussi bien du côté israélien que du côté arabe, même si ce n’est pas pour les mêmes raisons : pour lui, si l’État hébreu venait à se doter de l’arme nucléaire, il provoquerait une course aux armements avec les pays arabes aidés par l’URSS, fragilisant ainsi sa position au lieu de la consolider.
Empêcher le contrôle des armements
Fort de ses connaissances en relations internationales, Paul Wolfowitz est envoyé à Washington à l’été 1969, pour y travailler au Committee to Maintain a Prudent Defense Policy (Comité pour le maintien d’une politique prudente de Défense), à la demande de Wohlstetter. Cet organisme, créé par deux grandes figures de la Guerre froide, Dean Acheson et Paul Nitze, respectivement secrétaire d’État et directeur de la planification du département d’État du président Truman, a pour objectif de convaincre le Congrès de la nécessité d’installer un bouclier anti-missiles, projet fermement combattu par plusieurs représentants états-uniens, notamment Edward M. Kennedy, William Fulbright, Albert Gore Sr, Charles Percy et Jacob Javits. Pour aider Nitze et Acheson dans leur combat, Wolfowitz est accompagné de Peter Wilson, un autre élève de Wohlstetter, et de Richard Perle, qui est alors fiancé à la fille de Wohlstetter. Les trois jeunes hommes mènent le combat de haute lutte, rédigeant des études scientifiques et distribuant des fiches techniques aux membres du Congrès. Ils organisent également l’audition du sénateur « pro-bouclier » Henry M. Scoop Jackson devant la commission sénatoriale consacrée aux questions d’armement. Un travail payant : à la fin de l’été 1969, les « faucons » l’emportent au Sénat par 51 voix contre 50. L’adoption du projet permettra ensuite à Nixon d’engager la négociation avec l’URSS sur le Traité des missiles anti-balistiques en position de force. Les discussions aboutiront à la signature de SALT I.

Henry « Scoop » Jackson
Cet épisode marque un tournant dans la politique de Défense états-unienne, puisqu’il s’agit de la première victoire des « faucons » depuis 1941 et le vote par le Congrès de l’extension de la conscription en temps de paix. De plus, le succès de Nitze et Acheson permet l’ouverture d’un débat concernant le bouclier anti-missiles, débat qui continue encore aujourd’hui. Surtout, il a renforcé les convictions de Paul Wolfowitz et Richard Perle en matière de désarmement : les deux jeunes gens ressortent de cette lutte politique avec une grande méfiance envers tout processus de contrôle de l’arsenal états-unien, convaincus qu’une telle politique est défavorable aux États-Unis, tant d’un point de vue stratégique que psychologique. Par ailleurs, la participation à une entreprise politique aussi délicate que celle qui leur a été confiée par d’éminents théoriciens de la Guerre froide leur promet un avenir radieux à Washington.
Alors que son camarade Perle s’engage immédiatement en politique, en devenant l’assistant au Sénat de Henry « Scoop » Jackson, Wolfowitz reprend un temps ses études à Chicago, où il achève son doctorat. Mais les sirènes de Washington le rappellent bien vite : en 1973, l’Agence pour le contrôle des armes et le désarmement subit une véritable purge, sous l’influence de Scoop Jackson qui soupçonnait l’ancienne équipe d’être trop disposée à négocier avec l’ennemi soviétique. Fred Iklé, un stratège « faucon » de la Rand, prend la direction du département. Sur la recommandation de Wohlstetter, il choisit de recruter Wolfowitz. Celui-ci devient rapidement son plus proche conseiller. Il rédige pour lui des notes sur le lancement des missiles et leur détection, travaille sur les négociations liées au contrôle des armements, et suit Iklé en tourné à Paris et dans les capitales européennes.

Henry Kissinger
Son plus haut fait d’armes date de 1974 et 1975 : pendant deux ans, il s’implique dans la campagne de pression menée par les États-Unis auprès de la Corée du Sud afin qu’elle renonce à un programme de développement de plutonium. Wolfowitz cherche à cette époque à remettre en cause la politique étrangère d’Henry Kissinger vis-à-vis de l’Union soviétique, et même plus largement, la vision statique du monde développée par l’admirateur de Metternich. Il souhaite, en réalité, incarner l’alternative intellectuelle de Kissinger. Pour cela, il fait venir à ses côtés certains jeunes universitaires tels que son ami Francis Fukuyama.
L’expert en création de menaces
Efficace dans son travail, qui consiste à faire du contrôle des armements une coquille vide, Wolfowitz est rapidement assimilé à ce qu’il convient d’appeler les experts « alarmistes », toujours utiles lorsqu’il s’agit de gonfler - voire de créer - une menace pour faire voter une augmentation du budget militaire. C’est donc naturellement qu’il est invité à participer à la fameuse « équipe B », créée en 1976 par le directeur de la CIA de Gerald Ford, George H.W. Bush, afin de réévaluer la menace soviétique, prétendument sous-estimée par les experts trop pantouflards de l’Agence [4]. Cette équipe B est présidée par Richard Pipes, le père de Daniel Pipes. Pour rendre leur rapport, ses membres décident de se fonder sur les déclarations publiques des dirigeants soviétiques, plutôt que sur les traditionnelles photos satellites. Sans surprise, leur estimation finale, parue fin 1976, assure que l’Union soviétique pourrait prochainement reprendre l’avantage dans la course aux armements, en vue d’établir « une hégémonie soviétique globale ». Wolfowitz réalise alors que sous couvert d’indépendance, il est possible de passer outre le travail réalisé par les agences de renseignement. Il aura recours à ce procédé à plusieurs reprises dans sa longue carrière politique.
L’avantage du statut d’expert, c’est qu’il a la réputation d’être « indépendant ». Wolfowitz ne fait donc pas les frais de l’arrivée au pouvoir de Jimmy Carter. Il faut dire que deux de ses plus proches alliés politiques, le sénateur Henry Jackson et Richard Perle, sont des démocrates. Il obtient donc un poste au Pentagone, où il est responsable des « programmes régionaux ». En réalité, il se charge d’évaluer les problèmes que pourrait rencontrer le Pentagone à l’avenir. Le secrétaire à la Défense, Harold Brown, lui demande notamment d’examiner les menaces pesant sur l’armée états-unienne dans le Tiers-Monde. Wolfowitz se focalise alors sur la région du Golfe arabo-persique, en créant un programme de recherche, le Limited Contigency Study. À l’époque, le premier choc pétrolier a alerté les États-Unis sur l’importance stratégique du contrôle des régions riches en ressources énergétiques, notamment l’Arabie saoudite.
1976 : la première « menace » irakienne de Paul Wolfowitz
Dans le cadre de sa nouvelle affectation, Paul Wolfowitz assiste à un séminaire de Geoffrey Kemp, un jeune professeur à la Fletcher School of Law and Diplomacy. Ce dernier affirme que les États-Unis se focalisent trop sur l’Europe et ne prennent pas assez au sérieux les conséquences d’une éventuelle percée soviétique dans le Golfe. Wolfowitz le recrute immédiatement au sein du Limited Contigency Study, tout comme Dennis Ross, alors un jeune spécialiste de l’Union soviétique et futur négociateur au Proche-Orient du gouvernement Clinton. L’équipe, dont les locaux sont au Pentagone, ne s’intéresse pas qu’à une possible prise de contrôle des champs pétroliers par l’URSS. Elle envisage également que cette OPA sur l’or noir soit réalisée par une puissance régionale du Golfe, en étudiant par exemple l’éventualité d’une attaque irakienne contre l’Arabie saoudite. La très forte improbabilité d’une telle opération ne gêne pas Wolfowitz : selon lui : « Il ne faut pas se focaliser exclusivement sur la probabilité d’un événement, mais aussi sur la gravité de ses conséquences ». Une méthode de travail particulièrement pertinente si l’objectif est non pas de se prémunir d’une menace, mais de la construire.
D’un point de vue militaire, les conclusions du programme d’études du jeune Wolfowitz sont limpides : les États-Unis doivent renforcer leur présence dans la région du Golfe, notamment en y construisant de nouvelles bases militaires. Il faut également se méfier de l’avènement d’une puissance régionale trop importante, telle que l’Irak ou, à l’époque, l’Iran. Une recommandation qui ne restera pas lettre morte : trois ans plus tard, la CIA renverse le shah devenu trop exigeant, lui préférant même un régime islamique anti-états-unien qu’elle estime pouvoir contrôler, avec le succès que l’on sait [5]. Il s’agit là d’une opération en totale rupture avec la politique mise en œuvre par Nixon et Kissinger, c’est-à-dire de faire de l’Iran un régime pro-occidental lourdement armé, garant de l’équilibre régional. Le renversement du chah provoque d’ailleurs, ce n’est pas un hasard, un regain d’intérêt pour le travail de Wolfowitz et de ses amis : subitement, le Pentagone cherche à établir des bases à Oman, au Kenya ou en Somalie, encourage les gouvernements amis du Proche-Orient à construire des aéroports plus importants et tente de renforcer sa présence dans le Golfe pour permettre un déploiement rapide. Un an plus tard, les troupes états-uniennes et égyptiennes mènent ensemble un exercice militaire baptisé Bright Star, tandis que les forces états-uniennes développent, d’une manière générale, des technologies militaires destinées au combat en zone désertique. Le jour de la prise de pouvoir de Ronald Reagan, le 20 janvier 1981, la nouvelle administration annonce la création du CENTCOM, le centre de commandement militaire états-unien au Proche-Orient.
La période « asiatique »
La place de Wolfowitz n’est pas assurée au sein de la nouvelle équipe de la Maison-Blanche. En effet, ayant participé à l’administration Carter et étant proche de personnalités dites « démocrates », son pedigree n’est pas blanc-blanc pour l’administration Reagan, très proche de l’extrême droite. Averti fin 1979 par Fred Iklé sur le danger de rester à son poste jusqu’à la fin de la campagne, Wolfowitz démissionne début 1980, et redevient professeur associé au sein de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Il n’en reste pas moins suspect pour la Maison-Blanche. Richard Allen, nouveau conseiller à la sécurité nationale, refuse au départ de le voir rejoindre l’équipe « Politique étrangère » de Ronald Reagan. Il faudra toute la persuasion de John Lehman, son ami et ancien proche de Wolfowitz sous Nixon, pour le convaincre de l’intérêt d’un tel recrutement. Puis au moment de sa nomination, c’est le sénateur Jesse Helms qui rechigne à donner son feu vert à celui qu’il voit alors comme un dangereux libéral. Wolfowitz invite alors le directeur de cabinet du sénateur, John Carbaugh, pour lui donner des gages de néo-conservatisme. Il obtient finalement le poste de directeur de la planification au Département d’État. Comme sous Carter, il est chargé d’élaborer une vision à long terme des évolutions géopolitiques, et du rôle diplomatique à jouer pour les États-Unis. Un poste à responsabilité, occupé par le passé par George Kennan, le théoricien de la Guerre froide. Wolfowitz recrute pour cela une équipe fournie : Scooter Libby, juriste de Philadelphie, l’économiste Francis Fukuyama, le conservateur afro-américain Alan Keyes, mais aussi Zalmay Khalilzad, qui a l’avantage de venir de l’Université de Chicago et d’être un ancien élève de Wohlstetter.

Zalmay Khalilzad
Certaines de ses recrues sont des démocrates, comme Dennis Ross et Stephen Sestanovich, proche d’Allan Bloom et ancien étudiant à Cornell, en même temps que Wolfowitz.
Les recommandations du nouveau responsable de la planification du département d’État sont en rupture avec la politique étrangère menée jusque-là par les États-Unis, et plus particulièrement sous Carter : Wolfowitz remet en cause le bien-fondé de la vente d’avions de surveillance AWACS à l’Arabie saoudite, réclame une prise de distance de Washington vis-à-vis de l’Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, et se montre un des plus virulents défenseurs d’Israël au sein de l’administration Reagan. Mais c’est sur le dossier chinois qu’il choque le plus : la doctrine Kissinger préconisait jusque-là de considérer la Chine comme un pays trop puissant pour être ignoré, avec lequel il faudrait nécessairement négocier pour s’en faire un allié objectif dans la lutte contre l’URSS. Selon un mode d’argumentation déjà rodé, Wolfowitz dénonce cette vision des choses. Selon lui, les États-Unis ont depuis trop longtemps surévalué l’importance de la Chine alors qu’elle est en réalité bien plus menacée par Moscou que ne le sont les États-Unis. C’est donc Pékin qui a besoin de Washington, et non l’inverse. Il n’y a aucune concession à faire à la Chine, bien au contraire. Un tel discours met naturellement hors de lui Alexander Haig, le secrétaire d’État de l’époque, ancien assistant d’Henry Kissinger. La rumeur gronde même pendant quelques jours d’un départ imminent de Wolfowitz. Il n’en sera rien. Le 25 juin 1982, c’est Haig qui est remplacé par George Shultz, consacrant la rupture de l’administration Reagan avec la doctrine Nixon-Kissinger et ouvrant, au passage, une voie pour les idées défendues par Wolfowitz. Ce dernier est promu au poste de sous-secrétaire d’État pour l’Asie orientale et le Pacifique. Il s’agit là du premier emploi de terrain pour le bureaucrate universitaire du Pentagone.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Wolfowitz entre en relation avec deux figures clés de l’administration Reagan sur l’Asie que sont Richard Armitage, qui représente le Pentagone, et Gaston Sigur, du National Security Council (Conseil pour la sécurité nationale, NSC). Les trois hommes, qui se réunissent tous les lundis, coordonnent ensemble la politique étrangère de Washington dans la région asiatique. L’un des plus épineux dossiers qu’ils auront à traiter concerne les Philippines, où ils organisent le retrait politique du dictateur Ferdinand Marcos en 1986. Alors que celui-ci a bénéficié jusque-là d’un soutien indéfectible de Washington, l’équipe « asiatique » de Ronald Reagan s’inquiète de voir le pays en proie à une opposition de gauche de plus en plus mobilisée. L’arrivée au pouvoir des « communistes » pourrait entraîner la sortie des Philippines du giron états-unien, occasionnant au passage la fermeture de deux bases de l’US Army installées sur l’archipel, la Clark Air Force Base et la Subic Bay Naval Station. Ils incitent donc Marcos à intégrer une partie de son opposition dans son gouvernement. En vain : le vieux dictateur est convaincu qu’il ne sera jamais « lâché » par Ronald Reagan, qui l’a reçu à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Il se trompe : les trois responsables Asie le chassent du pouvoir et mettent fin à la dictature au profit de la droite catholique et de l’Opus Dei.
Cet épisode ne révèle pas une préférence de Washington pour les régimes démocratiques. Il permet uniquement de constater que le Pentagone et le département d’État sont prêts à soutenir l’instauration d’un régime démocratique si le maintien d’une dictature risque d’entraîner la prise de contrôle du pays par les « communistes ». En cela, ce n’est pas en tant que pro-démocratie que Wolfowitz a choisi cette politique, mais bien en tant qu’anti-communiste.
De manière symptomatique, la gestion des Philippines est rapidement critiquée par Henry Kissinger, qui met en cause le revirement états-unien vis-à-vis de Marcos, un allié fidèle de Washington depuis longtemps. Selon lui, un tel « lâchage » pourrait entraîner une déstabilisation d’autres régimes autoritaires, tels que la Corée du Sud, la Thaïlande, ou encore l’Indonésie. Wolfowitz, en revanche, affirme que les États-Unis ne peuvent reprocher à l’URSS son autoritarisme et dans le même temps tolérer dans leur camp des pays non-démocratiques. Ce que semble proposer ici le diplomate états-unien, c’est un revirement complet de la politique étrangère états-unienne, sur la base de la « promotion de la démocratie ». Il n’en sera évidemment rien. Seuls les régimes autoritaires instables seront remplacés, et pas nécessairement par des démocraties. En bon garant de la stabilité régionale, Paul Wolfowitz est d’ailleurs nommé ambassadeur des États-Unis en Indonésie, jusqu’à la fin du second mandat de Ronald Reagan.
Retour en Irak
L’arrivée au pouvoir de George H.W. Bush ramène Wolfowitz à Washington, au même poste qu’au début de l’ère Regan : sous-secrétaire à la Défense, en charge de la politique du Pentagone, particulièrement sur les questions de désarmement, du Proche-Orient et du Golfe persique. Il y reprend son travail mené sous Jimmy Carter, en demandant une évaluation de la capacité états-unienne à défendre les champs pétrolifères saoudiens. Cette fois, l’éventualité d’une intervention soviétique est écartée, pour se focaliser sur les puissances régionales, au premier rang desquelles figure l’Irak.
Il y a fort à parier que la stratégie états-unienne qui a consisté à provoquer le régime de Saddam Hussein afin de le pousser à envahir le Koweït a été en partie élaborée par Wolfowitz. L’objectif d’une telle tactique était claire : elle permettait à l’armée états-unienne de se déployer massivement dans la région, et particulièrement en Arabie saoudite, mais aussi de réduire à néant la puissance accumulée par Bagdad, avec l’approbation de Washington, au cours des quinze dernières années. Plusieurs éléments permettent d’envisager la participation de Wolfowitz à l’élaboration d’un tel scénario : d’une part, son poste au Pentagone lui permettait d’être associé à de telles décisions ; d’autre part, la nécessité d’un déploiement de troupes états-uniennes dans la région était depuis longtemps une de ses principales préoccupations. Enfin, un épisode troublant a été raconté par Dennis Ross. Au cours d’un voyage effectué dans la région à cette époque, Ross a la surprise de voir son compagnon de route James Baker lui présenter des documents accréditant l’hypothèse (plus tard totalement infirmée) d’une attaque irakienne contre l’Arabie saoudite. Or, ces documents, il les connaissait déjà : il s’agissait d’une simple mise à jour de ses propres travaux de la fin des années 1970 pour le compte du Limited Contigency Study de Wolfowitz.
Les prises de position du sous-secrétaire à la Défense sont d’ailleurs extrêmement claires : il ne faut pas négocier avec Saddam Hussein le retrait des troupes irakiennes du Koweït, mais profiter de l’aubaine pour dévaster le pays. Avec Richard Cheney, il œuvre même à l’élaboration d’un plan d’attaque, conçu par Henry S. Rowen, membre de la Stanford Business School et du Hoover Institute, en alternative au plan du général Colin Powell, alors chef d’état-major interarmes, et du général Norman Schwarzkopf. L’avantage de ce plan, qui prévoyait le déploiement de troupes depuis l’Arabie saoudite jusqu’aux alentours de Bagdad, afin de forcer Saddam Hussein à se retirer du Koweït, était d’assurer la protection d’Israël vis-à-vis d’éventuelles frappes balistiques. Il sera finalement rejeté. Rejetée également, à la fin de la guerre, la position défendue par Wolfowitz de poursuivre plus avant le conflit, une fois les objectifs atteints. Cette fois, c’est le chef d’état-major interarmes Colin Powell qui obtient gain de cause, en expliquant que les États-Unis « sont en train de tuer des milliers de personnes », rapporte James Baker dans ses Mémoires. Le cessez-le-feu « prématuré » est une énorme déception pour Wolfowitz qui, selon certains, préconisait d’envoyer l’armée jusqu’à Bagdad. À la fin des années 1990, il affirmera que la poursuite des combats aurait peut-être favorisé un coup d’État, et donc la chute de Saddam Hussein. Il tire, en tout état de cause, une leçon politique de cet épisode : à l’avenir, il lui faudra mieux contrôler le pouvoir militaire, s’il veut atteindre ses objectifs stratégiques.
Nouvel ordre mondial
La chute de l’Union soviétique entre 1989 et 1990, qui doit amener à un redéploiement des forces états-uniennes de par le monde, donne lieu à l’élaboration d’une nouvelle doctrine pour les néo-conservateurs et Paul Wolfowitz. Les responsables de la Défense états-unienne doivent en effet justifier devant le Congrès le maintien des dépenses militaires, à l’heure où le principal ennemi s’est effondré. Wolfowitz et Powell, pourtant opposés par le passé, développent ensemble l’idée d’une nécessaire force minimale d’intervention de l’US Army, afin d’être en mesure de parer à toute menace éventuelle.

Mais l’essentiel de la doctrine Wolfowitz est élaborée en 1992, dans le cadre du Defense Planning Guidance. Ce document, qui a été commandé par Richard Cheney, alors secrétaire à la Défense, a en réalité été rédigé par Zalmay Khalilzad, l’assistant de Scooter Libby au Pentagone, sur la base de réunions auxquelles participaient, alternativement, Richard Perle, Andrew Marshall, Paul Wolfowitz, ou encore Albert Wohlstetter. Dans le document qui a fuité dans la presse, l’auteur évoque un nouvel « ordre mondial [...] au finale soutenu par les États-Unis », dans lequel l’unique superpuissance n’aurait plus que des alliances conjoncturelles, au gré des conflits. L’ONU et même l’OTAN seraient de plus en plus mises sur la touche. Plus largement, la doctrine Wolfowitz théorise la nécessité pour les États-Unis de bloquer l’émergence de tout compétiteur potentiel à l’hégémonie états-unienne, notamment les « nations industrielles avancées » telles que l’Allemagne et le Japon. Particulièrement visée, l’Union européenne : « Bien que les États-Unis soutiennent le projet d’intégration européenne, nous devons veiller à prévenir l’émergence d’un système de sécurité purement européen qui minerait l’OTAN, et particulièrement sa structure de commandement militaire intégré ». Les Européens seront ainsi priés d’inclure dans le Traité de Maastricht une clause subordonnant leur politique de défense à celle de l’OTAN [6], tandis que le rapport du Pentagone préconise l’intégration des nouveaux États d’Europe centrale et orientale au sein de l’Union européenne, tout en leur faisant bénéficier d’un accord militaire avec les États-Unis les protégeant contre une éventuelle attaque russe [7]
Après le scandale provoqué par la publication prématurée du document, Paul Wolfowitz se désolidarise un temps de sa rédaction, avant que le soutien de Dick Cheney à Khalilzad ne le convainquedes’y rallier. En réalité, l’assistant de Wolfowitz, Scooter Libby,qui va se charger de la seconde version du rapport, va même aller plus loin. S’il évite de désigner nommément l’Union européenne, il théorise explicitement la nécessité pour les États-Unis d’acquérir une supériorité militaire telle qu’elle décourage toutes les puissances émergentes de tenter de les concurrencer.
L’arrivée au pouvoir de Bill Clinton en 1992 renvoie Paul Wolfowitz à ses chères études. Il reprend son poste à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, où il développe ses théories sur l’obligation pour les États-Unis de conserver une « profondeur stratégique », un euphémisme qui renvoie au fait d’être la seule superpuissance mondiale. En 1996, il est choisi par Donald Rumsfeld, qui dirige la campagne présidentielle du candidat républicain Bob Dole, pour être le pourvoyeur d’idées en matière de politique étrangère.
Mais son obsession reste le Proche-Orient et le dossier irakien. Après avoir plusieurs fois regretté que l’armée US ne soit pas restée plus longtemps sur le sol irakien, afin de renverser Saddam Hussein, il écrit, en 1997, un article intitulé « Les États-Unis et l’Irak » dans lequel il préconise l’instauration d’un nouveau régime à Bagdad, sans préciser la manière d’y parvenir [8]. À la fin de l’année, il va même plus loin en co-signant un article avec Zalmay Khalilzad dans le Weekly Standard, le magazine des néo-cons. Le titre est éloquent : « Renversez-le », en référence au dictateur irakien [9]. À l’époque, il développe sa vision personnelle d’un renversement réussi, qui passerait par un soutien armé au sud du pays, puisqu’il affirme préférer travailler avec les opposants chiites qu’avec les Kurdes. Et il évoque déjà la nécessité de rallier les alliés récalcitrants, dont l’hésitation s’explique par le manque de détermination de l’administration Clinton. L’arrivée au pouvoir d’une équipe de « faucons » devrait donc avoir raison de ces réticences. D’autant que, selon lui, la Russie et la France devraient facilement se laisser convaincre par « le vent du pétrole ». Si ces prédictions se sont révélées fausses, la démarche de Wolfowitz a reçu sa consécration aux États-Unis, où, en 1998, de nombreuses figures éminentes du Parti républicain rallient le Projet pour un nouveau siècle américain dont l’une des premières revendications est la destitution de Saddam Hussein. Au même moment, Wolfowitz est invité à participer au Congressionnal Policy Advisory Board, monté au sein du Parti républicain par Martin Anderson pour permettre l’élaboration d’une politique étrangère néo-conservatrice, avec le soutien financier du Hoover Institute, de la Fondation Heritage et de l’American Entreprise Institute. Donald Rumsfeld et Dick Cheney y assistent régulièrement, tandis que Colin Powell est délibérément écarté, tout comme Richard Armitage.
Wolfowitz n’est pas en reste. Il participe, toujours en 1998, à la commission d’enquête du Congrès chargée d’examiner la réalité de la menace d’une frappe balistique sur les États-Unis, dirigée par Donald Rumsfeld. Sur le modèle de l’« Équipe B » montée par George H.W. Bush au milieu des années 1970, cette commission doit réexaminer les données fournies par les agences de renseignement et en proposer, si nécessaire, une interprétation différente. La communauté du renseignement états-unien avait en effet conclu, en 1995, qu’aucune puissance en dehors des États nucléaires déclarés n’aurait la possibilité de toucher le territoire états-unien avec un missile avant quinze ans. Il s’agissait donc pour le complexe militaro-industriel, et notamment les partisans du bouclier anti-missiles, au premier rang desquels figurent Paul Wolfowitz et Newt Gringrich, de remettre en cause ces conclusions jugées beaucoup trop optimistes. La commission fait parfaitement son travail : Donald Rumsfeld parvient à rallier le soutien des trois démocrates membres du comité, et notamment de Richard Garwin, officiellement opposé au bouclier antimissile. La commission accrédite ainsi l’idée d’une réelle menace de frappe balistique, en provenance de la Corée du Nord, de l’Iran et de l’Irak. En 1999, toujours dans le cadre du Projet pour un nouveau siècle américain, Wolfowitz signe une pétition en faveur de Taiwan, qui devrait, selon le texte, pouvoir bénéficier de la protection des États-Unis en cas d’agression chinoise.

Paul Wolfowitz (gauche) en
compagnie de Donald Rumsfeld
et George W. Bush
Devenue une figure clé des néo-conservateurs, il est recruté par George W. Bush à l’automne 1998, afin de lui servir d’assistant sur les questions de politique étrangère, aux côtés d’une personnalité alors très proche du candidat républicain, Condoleezza Rice. Avec elle, il met en place l’équipe des « Vulcains », en référence au dieu romain qui forge les armes divines dans la profondeur des volcans. Spécialisée en relations internationales, l’équipe comprend huit membres : Rice et Wolfowitz, naturellement, mais aussi Richard Armitage, Richard Perle, Dov Zakheim [10], Stephen Hadley, Robert Blackwill et Robert Zoellick. Au même moment, une deuxième équipe, menée par Rumsfeld, est également créée dans le sillage de la campagne de George W. Bush. Son objectif : promouvoir le projet de bouclier anti-missiles. On y trouve plusieurs Vulcains (Rice, Wolfowitz, Hadley et Perle), mais aussi des personnalités extérieures telles que George Schultz ou Martin Anderson. La très grande implication de Paul Wolfowitz dans la campagne présidentielle de George W. Bush - qu’il briefe notamment avec Condoleeza Rice avant le débat télévisé avec Al Gore - mérite une récompense après la victoire finale. Celle-ci se concrétise par le retour au bercail de l’ « enfant du Pentagone », cette fois en position de n°2.
Paul Labarique








[1] Voir « Skull and Bones, l’élite de l’empire », Voltaire, 8 juillet 2004.
[2] Leo Strauss n’a pas influencé uniquement des néo-conservateurs tels que William Kristoll, William Bennett, Paul Wolfowitz ou Francis Fukuyama. William Galston, l’un des intellectuels en vue du temps de la présidence Clinton, a suivi, comme Wolfowitz, les cours de Bloom à Cornell, puis ceux de Strauss à Chicago.
[3] Entretien avec James Mann, cité dans Rise of the Vulcans - The History of Bush’s War Cabinet, de James Mann, Viking, 2004.
[4] Voir « Les marionnettistes de Washington » par Thierry Meyssan, Voltaire, 13 novembre 2002.
[5] Voir Affaires atomiques, de Dominique Lorentz, Éditions les arènes, 2001.
[6] « La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour certains États membres du traité de l’Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ». In Traité de Maastricht, titre V, article J4, paragraphe 4 .
[7] L’affaire est révélée dans « US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop » par Patrick E. Tyler, in New York Times du 8 mars 1992. Le quotidien publie également de larges extraits en page 14 : « Excerpts from Pentagon’s Plan : "Prevent the Re-Emergence of a New Rival" ». Des informations supplémentaires sontapportées dans « Keeping the US First, Pentagon Would preclude a Rival Superpower » par Barton Gellman, in The Washington Post du 11 mars 1992.
[8] « The United States and Irak », par Paul Wolfowitz, in The Future of Iraq, ed. John Calabrese, Middle East Institute, 1997.
[9] « Overthrow him », par Zalmay Khalilzad et Paul Wolfowitz, Weekly Standard, 1er décembre 1997.
[10] « Dov Zakheim, la caution du Pentagone », par Paul Labarique, Voltaire, 9 septembre 2004.
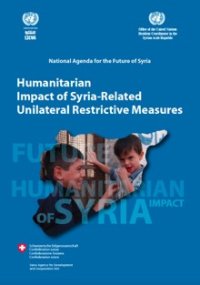






 del.icio.us
del.icio.us
 Imprimer
Imprimer Digg
Digg

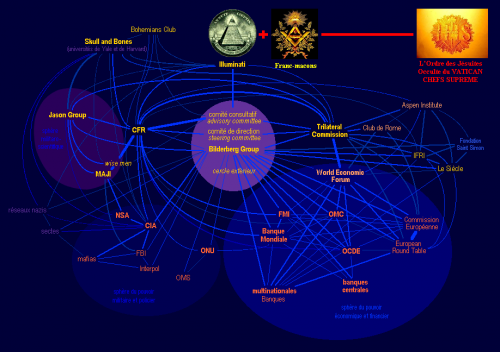

 Selon un sondage publié début mai, la moitié des Français seraient des adeptes de la théorie du complot : ils considèrent que "ce n'est pas le gouvernement qui gouverne la France" et qu'"on ne sait pas en réalité qui tire les ficelles".
Selon un sondage publié début mai, la moitié des Français seraient des adeptes de la théorie du complot : ils considèrent que "ce n'est pas le gouvernement qui gouverne la France" et qu'"on ne sait pas en réalité qui tire les ficelles".






